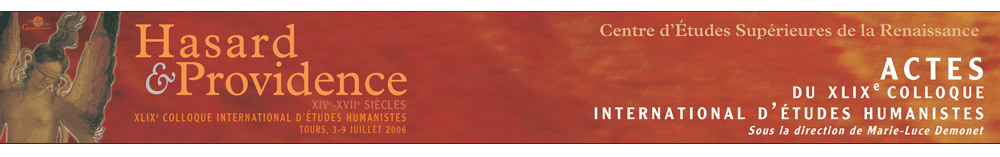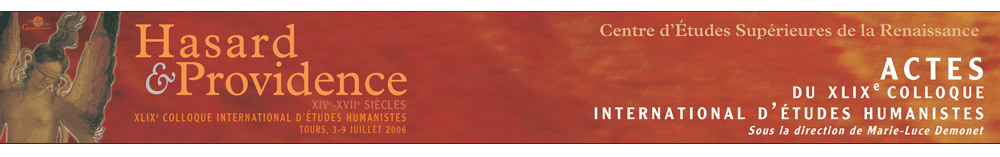
Hasard et Providence – Avril 2007
Séance inaugurale
Claude-Gilbert Dubois
Hasard et nécessités ou l’art d’effeuiller les roses
Robert Halleux
Hasard et Providence comme écheveau de traditions
Séances plénières
Claude-Gilbert Dubois
Pré-voyance et liberté divines dans la conception de l’Histoire (1560-1610)
Michel Jeanneret
Les monstres et la question des causes
Communications
Thomas Berns
Machiavel : « a-t-on besoin de la Fortune pour justifier la grandeur de la Rome antique ? »
Gilles Bertheau
Ni hasard, ni providence : le héros chapmanien pris au piège du machiavélisme
Marie-Hélène Besnault
Le hasard, la providence et le « bain du diable » : Robert Burton et la mélancolie religieuse
Mario Biagioni
L’homme comme « un dieu terrestre » : le problème de l’immortalité d’Adam, de Francesco Pucci à John Locke
Élise Boillet
Service courtisan et liberté du lettré : Castiglione, l’Arioste, l’Arétin
Gloria Bossé-Truche
Les représentations de la Prudence et de la Providence dans quelques recueils d’emblèmes espagnols (XVIe-XVIIe siècles)
Pierre Caye
Art, virtus et fortuna. Le différend Pétrarque /Alberti sur le sens des arts plastiques et sur leur capacité à surmonter la fortune
Bernard Chevalier
À propos des lectures providentielles de l’histoire. Le cas de la première guerre d’Italie
Bruna Conconi
«Sans rien attribuer à fortune, comme les hommes profanes font» : l’intellectuel protestant aux prises avec le désordre de l’histoire
Marie-Dominique Couzinet
Hasard, providence et politique chez Jean Bodin
Nathalie Dauvois
Fortune, histoire et Providence dans quelques œuvres de Jean Bouchet
Phillippe Desan
« Le hazard sur le papier » ou la forme de l’essai chez Montaigne
Lucia Felici
La libertà dell’arbitrio nel pensiero di un intellettuale europeo del tardo Rinascimento : Justus Velsius
Roger Friedlein
Le hasard dans la philosophie morale. Un jeu de plateau de João de Barros : Diálogo sobre Preceitos Morais (1540)
Stéphan Geonget
Panurge et le choix à « trois beaux dez ».
Violaine Giacomotto-Charra
La main de Dieu et les lois de la physique : nature et providence dans la poésie bartasienne
Robert Halleux
Le mineur et l’alchimiste. La systématisation des savoirs aléatoires au XVIe siècle
Richard Hillman
Hamlet, jeu de hasard et jeu de Providence : l’histoire, la tragédie et l’histoire tragique
Florence Jutier-Buttay
Usages politiques de l’allégorie de la Fortune à la Renaissance : l’exemple du tournoi organisé par Jean II de Bologne en 1490
Eberhard Knobloch
La mort, les catastrophes et les assurances chez Leibniz
Nelly Labère
Jeu de hasard et jeu d’adresse. Poétique des formes narratives brèves médiévales
François Laroque
Star-crossed lovers : le destin et les étoiles dans Roméo et Juliette
Chiara Lastraioli
Divinazioni burlesche e satiriche in Italia e in Francia
Françoise Lavocat
Jeux d’adresse et de hasard dans quelques mondes fictionnels au tournant des XVIe et XVIIe siècles
Alain Legros
Montaigne entre Fortune et Providence
Frédérique Lemerle
Architecture et accidents au XVIe siècle. Le Settimo libro de Sebastiano Serlio
Frank Lestringant
Providence et Imago Mundi
Vladislava Lukasik
Nature et fortune : mère et marâtre
Paul-Alexis Mellet
L’ange et l’assassin : les vocations extraordinaires et le régicide jusqu’en 1610
Viviane Mellinghoff-Bourgerie
« C’est un coup de hasard, et plus que cela » : le discours providentialiste des épistoliers spirituels tridentins, de Bonsignore Cacciaguerra à François de Sales
Daniel Ménager
La prudence du diplomate
Hélène Michon
La prédestination, querelle de mots ou querelle de choses ?
Philippe Morel
Entre destinée et occasio, de la virtù du prince aux arcanes du pouvoir
John O'Brien
Hasard et providence dans le Sud-Ouest : Montaigne et ses amis et voisins
Alfredo Perifano
Fortune et medico fortunato dans Della fortuna libri sei de Girolamo Garimberto
Dominik Perler
Le hasard est-il possible ? Spinoza, critique des conceptions scolastiques de la contingence
Bruno Pinchard
Bifurcations et germinations. La Théodicée entre hasard et providence
Aurélie Plaut
Signes de Dieu, Signes du diable : la lecture providentielle de la naissance du « monstre » protestant chez Florimond de Raemond
Orest Ranum
Le Hasard, la Prudence et la Providence dans la pensée du Cardinal de Richelieu
François Rigolot
La place du hasard dans les « erreurs de nature » : de Jérôme Cardan à Francis Bacon
Robert Sauzet
Miracles et Contre-Réforme en France au XVIIe siècle
Francesco Sberlati
Storia e provvidenza divina nella Gerusalemme liberata di Torquato Tasso
Katelijne Schiltz
« Casus ubique valet » ? Josquin, Cerone et les dés dans la musique de la Renaissance
Martin Schmeisser
Oracles, miracles et antiprovidentialisme dans le De Admirandis : Jules César Vanini, un émule de Lucien ?
Kirsti Sellevold
Ordre et hasards de la communication : le cas des Essais
Alexandre Tarrête
Présages et prodiges chez Jacques-Auguste de Thou (1553-1617)
Olivier Guerrier et André Tournon
Lectures de Plutarque au XVIe siècle : la fortune providentielle
Christian Trottmann
Hasard et providence dans le commentaire de Denys le Chartreux à la Consolation de la Philosophie de Boèce
Jacqueline Vons
L’anatomiste et la mort annoncée
Myriam Yardeni
Prédestination, vocation et décisions morales et politiques chez Théodore de Bèze
Jean-Claude Zancarini
Résister à la fortuna : Francesco Guicciardini (1483-1540) et l’infinie variation des choses du monde
Pierre Caye
Art, virtus et fortuna. Le différend Pétrarque /Alberti sur le sens des arts plastiques et sur leur capacité à surmonter la fortune
[Résumé]
Se met en place à partir de Pétrarque jusqu’à Machiavel, voire Montaigne, ce que j’appelle une réforme radicale du stoïcisme et en particulier du stoïcisme impérial, d’un stoïcisme qui fait l’économie de la providence et dont témoigne clairement le fameux couple fortuna et virtus, opérateurs présents et actifs dans une grande part de la culture humaniste. C’est un moment singulier et privilégié de la pensée que recouvrira le néo-stoïcisme de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècles, entretenant, à l’exemple de Juste Lipse, un rapport plus orthodoxe à ses sources, et en particulier à ses sources grecques. De fait, la suspension de la providence entraîne une relecture profonde des grandes notions du stoïcisme, tel que Cicéron, en particulier, l’avait transmis à la postérité, de la virtus au premier chef, mais aussi de la commendatio (l’oikeiosis du stoïcisme grec), du temps, du rapport de la morale à la physique et à la physiologie, etc., qui, à mon sens, implique non seulement une refondation de l’anthropologie humaniste et de sa politique, mais plus encore l’invention de la question technique, comme en témoigne l’instauration albertienne de la théorie de l’art, ou encore de la question économique comme le montre le Della famiglia du même Alberti. Nous nous attacherons dans le cadre de notre réflexion, à montrer quels liens unissent, en cette affaire, Pétrarque à Alberti, et en quoi celui-ci accomplit un geste initié par celui-là.